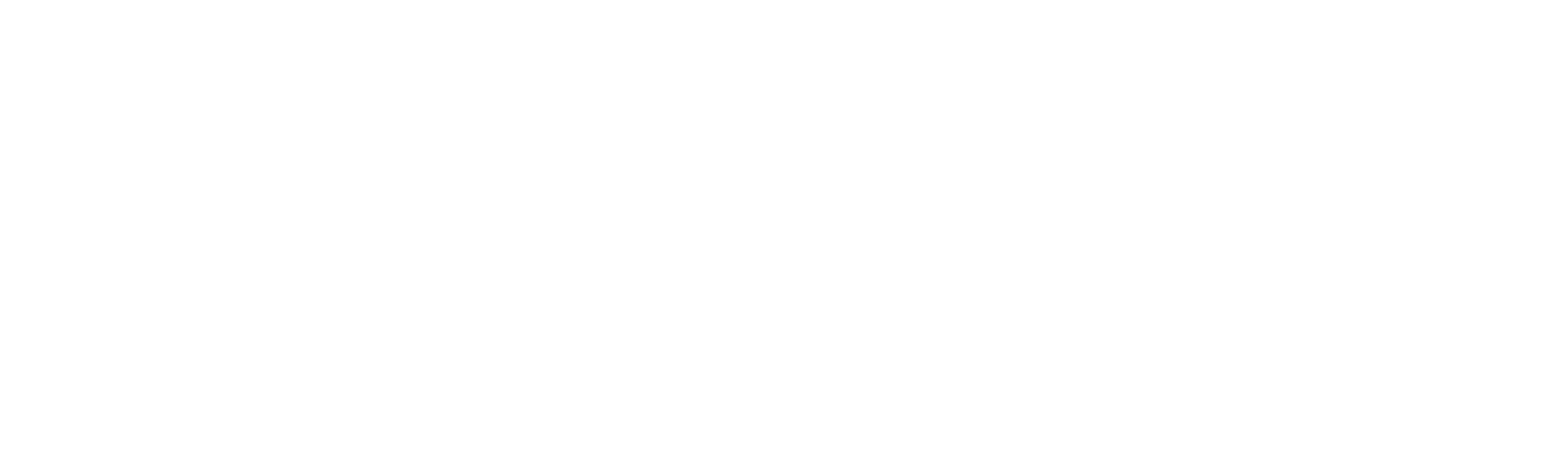Arts et sciences: transdisciplinarité
Croiser les savoirs et pratiques scientifiques et artistiques est
une manière de faire dialoguer les entités humaines et non-humaines,
qu’elles soient naturelles ou artificielles, matérielles ou
immatérielles, offrant à certain.es chercheur.es de la ZATU, un nouveau
terrain de travail. Le terme de « recherche-création » englobe
l’ensemble des pratiques qui, à l’interface entre arts, sciences et
sociétés « bouleversent les modes d’acquisition des connaissances »et
permettent de toucher la part sensible de notre rapport à des milieux
singuliers comme ceux marqués par la radioactivité naturelle ou
naturelle renforcée par l’homme. Notre intuition est que la
recherche-création peut être un outil de dialogue transdisciplinaire
propice à faire émerger des imaginaires et construire des récits
partagés en « rendant sensible » des connaissances scientifiques
« froides », et en aidant à transformer le « concernement » des
citoyens en véritables traces mémorielles. Sa capacité à produire du
sens et de l’action dépend toutefois de l’équilibre à trouver entre
connaissance scientifique, savoirs empiriques et pratiques artistiques
(Martinaud, 2025)
Depuis 2023 plusieurs expériences ont permis de
tester ces interfaces arts-sciences-sociétés ouvrant des espaces
d’échanges avec des habitant.es, des étudiant.es pour mieux comprendre
le rapport social et les imaginaires de la radioactivité et des
socio-écosystèmes qu’elle influence. Sur le site-atelier de Rophin
ainsi qu’autour des sources minérales de Sainte-Marguerite (Saint
Maurice-ès-Allier) et des Saladis (Martres-De Veyre), des
collaborations ont débuté avec des artistes-chercheuses comme Céline
Domengie, Nicolas Fouassier et Charlotte Mariel, donnant lieu à des
entretiens avec des habitant.es, des créations artistiques, des
publications et des ateliers de travail. Deux édiitions du projet Chôra
piloté par C. Domengie ont été menés en 2024 et 2025. Un projet appelé
« Zone humide, zone sensible » mené sur le site atelier de Rophin et
piloté par Charlotte Mariel a débuté en juin 2025. Dans ce contexte
post-minier, l’enjeu est de tisser une mémoire qui articule les vécus
et les récits sur l’uranium et la radioactivité des milieux entre
sciences et société, car tous participent de la trajectoire
territoriale et de la réappropriation sociale de l’héritage ambigu et
pluriel laissé par les mines d’uranium(Martinaud, Becerra, Mallet,
Chardon, 2026, à paraître). D’autres travaux scientifiques s’appuyant
sur des savoirs autochtones et pratiques populaires (comme les
sourciers) s’intéressant à cette dimension sensible de l’expérience des
milieux, s’y sont rattachés.
En savoir plus:
Huet S., Mallet C., 2023. Le milieu et ses mesures.L’ancienne mine d’extraction d’uranium de Rophin, perception d’un territoire uranifère, Ed. ZATU: Clermont Ferrand.
Becerra S., Mallet C., Domengie C., 2025. Chôra, Ed. du Bram. Martinaud G. 2025. Radioactivité dans l’oubli : penser la mémoire du risque et l’intégration territoriale d’un site contaminé à l’aune des théories de la recherche-création. Mémoire de Master 2, Université Toulouse Jean Jaurès (Foix).
Martinaud G., Becerra S., Chardon P., Mallet C., 2026. Les traces de l’ancienne exploitation d’uranium de Rophin (Puy-de-Dôme, France) : comment hériter de « communs négatifs » confinés? in Tour du monde en 80 mines, Editions IRD, à paraître.
Carnet Hypothèses – Zone Art https://rzarts.hypotheses.org/category/zatu
Pour en savoir plus
Réseau National de Mesures de la radioactivité de l’environnement
L’émission « C’est pas sorcier » (France 3) sur la radioactivité